Saint-Nicolas des Étudiants
A la Saint Nicolas, je repense toujours à la Belgique de mes souvenirs (qui ne coincide pas forcément avec La Belgique), à Liège, à mes études à l'Université Catholique de Louvain et, fatalement aux étudiants buveurs de bière du cercle Agro qui baptisaient de leur urine ma terrasse et un de mes murs.
Il y a tout ça et bien d'autres choses encore dans mon Saint Nicolas des Etudiants.
Saint-Nicolas des Étudiants
Il faut avoir fréquenté Liège dans la semaine du six décembre pour percevoir ce que peut être la Saint-Nicolas des étudiants. C'est une ambiance, une tradition, voire un art de vivre, pour certains. De même qu'il y a le 15 août et son péké, la foire d'octobre et ses laquements, il y a décembre et les vomissures des joyeux étudiants liégeois.
Impossible de rater ces troupeaux de jeunes éméchés, vêtus de blouses - les tabliers - dont on peut se dire, à condition de ne point manquer d'imagination, qu'elles furent blanches à l'origine. Pour l'occasion, les tabliers affichent une teinte caniveau, là où les feutres et bombes de peinture ont laissé le tissu visible. Ils vont de par les rues de la cité ardente, le nez rouge et couverts de grandes chaînes, sous l'œil amer des SDF dont ils accaparent la clientèle.
Les étudiants se postent à tous les feux rouges, même quand ceux-ci sont verts, et demandent de l'argent à ceux qui s'arrêtent ou se contentent de ralentir leur véhicule. Les liégeois portent sur leurs enfants un regard attendri, complaisant. Ils leur accordent donc l'aumône de quelques pièces sans illusion aucune sur l'usage prévu pour la somme rassemblée. Le soir, le carré, quartier des cafés et des discothèques, est envahi de blouses sales. Il se sert plus de bouteilles et de canettes de bière qu'à l'accoutumée et les chopes sont transformées en urinoirs avant de s'écraser sur les murs de la ville. Les estomacs se révoltent contre l'ivresse et les excès, les tabliers se salissent encore, on rit, on pleure, et vive Saint-Nicolas !
Une légende raconte que tout l'argent récolté à l'occasion de la quête de la Saint-Nicolas est nécessairement bu avant le sept décembre. Cette information sur l'ivrognerie bon-enfant des fils et filles de Tchantchès et de Nanesse, aurait très bien pu rester anecdotique. Je notai cependant l'acharnement avec lequel on insistait sur ce point précis, et je subodorai le mystère derrière les apparences grossières de cette tradition.
À partir de ce moment-là, j'ouvris les yeux et les oreilles et, sans jamais poser de question directe, je menai mon enquête.
Loin de moi l'intention de vous conter par le menu les indices qui vinrent à moi, ni le détail des circonstances qui me les firent découvrir. Il me fallut plusieurs années pour me faire une idée claire sur ce sujet et je me propose de vous livrer, le plus simplement du monde, mes étonnantes conclusions.
Il faut, pour ce faire, remonter dans le passé jusqu'au IIIème siècle de notre ère, au temps de Nicolas Merin, le futur Saint-Nicolas. L'homme, ni pire, ni meilleur que vous ou moi, vivait dans le village de Liège, au confluent de la Legia et de la Meuse. Il avait la fâcheuse habitude de regarder par les trous de serrures. Il est vrai qu'à cette époque il n'y avait pas encore la télévision et ses fameux reality shows. Il ne restait, pour les gens curieux et voyeurs, que ce moyen répréhensible pour assouvir leur obsession. Nicolas, cependant, ne regardait jamais dans les serrures des portes dont il savait qu'elles donnaient sur une chambre à coucher ou une pièce d'ablutions. Sa conscience était avec lui car ce penchant constituait son seul et unique vice.
Un jour qu'il traînait non loin de la boucherie Foutard, Nicolas aperçut une porte qu'il n'avait jamais remarquée. Il eut l'impression que la serrure le fixait droit dans les yeux, racoleuse, prometteuse. Un regard à droite, un à gauche... rien derrière ?
Il s'approcha sans bruit de la porte de l'arrière-boutique du boucher et appliqua voluptueusement son œil sur le trou. Plus rien n'existait alors que cette forme minuscule qui donnait forcément sur de délicieux secrets et ne demandait qu'à les lui révéler. La pièce derrière la porte était plongée dans la pénombre il lui fallut un long instant pour discerner les mouvements correspondant aux bruits légers qu'il entendait déjà distinctement. Ce qu'il y découvrit le pétrifia. Père Foutard, le boucher, marchait de long en large dans sa remise, s'adressant à des gens que Nicolas ne pouvait voir. Il revenait toujours vers le grand saloir en répétant : « Que vais-je faire de vous, maintenant ? » et « Bah ! Si je mélange le tout avec du bœuf haché, ils n'y verront que du feu ».
Soudain une voix répondit à la litanie de l'homme au tablier sanglant. C'était une plainte d'enfant : « S'il vous plaît ! Laissez-nous partir, nous ne dirons rien à personne, mais de grâce, ne nous changez pas en salaison ! »
Nicolas retint un cri d'horreur et, résolu à agir pour sauver les enfants, observa la scène du drame à la recherche d'idées. Combien d'enfants pouvait contenir le saloir ? Valait-il mieux les délivrer par la porte ou par la petite fenêtre à l'autre bout ? C'est le cerveau bouillonnant de toutes ces questions que Nicolas rentra chez lui.
Plus tard, la nuit tombée, il revint sur les lieux avec une corde, au cas où, et de quoi crocheter la porte.
Tout se déroula comme il l'avait prévu. Nicolas libéra les trois enfants et, comme ils étaient morts de fatigue et encore tout effrayés de leurs mésaventures, il pensa qu'ils avaient besoin en priorité de manger et de dormir. Il les ramènerait à leurs parents respectifs dès l'aube.
Mais la nouvelle de la disparition des enfants avait fait son chemin. Le temps de rendre visite aux familles susceptibles d'héberger leurs petits, de faire le lien entre les trois et de décider s'il valait mieux chercher dans le village ou dans la forêt, deux jours s'étaient passés. Les pères des disparus s'organisèrent pour passer de maison en maison, afin de signaler le drame et de recueillir d'éventuels témoignages.
C'est ainsi qu'ils en vinrent à frapper, ce soir-là, aux carreaux de fenêtre de Nicolas, qui veillait sur le sommeil des trois anges.
« Chut ! » fit-il en ouvrant la porte doucement, « Ils sont si épuisés après ce qu'ils ont vécu ! ».
Les enfants dormaient sur un matelas de fortune, à quelques pas seulement de la porte et lorsqu'ils les aperçurent, les pères, furieux se jetèrent à bras raccourcis sur le pauvre Nicolas.
Il le battirent et l'injurièrent si bien que les enfants réveillés en sursaut se mirent à hurler tous les cris qu'ils gardaient en eux depuis deux jours.
Quelle effroyable méprise ! Que de cris, que de boucan !
Les enfants ramenés à leurs mamans étaient entourés de soins et sommés de ne plus penser à leur calvaire qu'on se gardait bien de mettre en mots.
Nicolas fut immédiatement enfermé à la maison d'arrêt dont les barreaux étaient renforcés par les témoignages défavorables de ceux qui, l'ayant déjà vu penché sur une serrure, l'estimaient terriblement pervers.
Des mois plus tard, lorsque le bon Nicolas passa en jugement, c'était le début du mois de décembre. Les enfants délivrés avaient plaidé en sa faveur... en vain. Le héros échappa à la mort, mais fut condamné à la réclusion à perpétuité. Il n'avait pas de famille et, les juges, en prononçant sa condamnation, s'attendaient à ce qu'après dix ans de prison au régime « pain sec et eau », Saint-Nicolas, comme l'appelaient ses co-détenus, mourrait.
Mais c'était compter sans la grâce et la reconnaissance. Les enfants du village organisèrent des collectes pour offrir à Nicolas une pension très décente qui lui permit de manger assez grassement tous les jours. Dieu, quant à lui, furieux de la bêtise des hommes, fit don à Saint-Nicolas d'une longévité hors du commun. Les enfants grandirent et transmirent à leurs petits frères la vérité sur le drame de Saint Nicolas. Puis, ils devinrent parents et oublièrent, comme tous les adultes, leur sens profond de la justice.
Pendant des siècles, les plus jeunes eurent connaissance du secret de Saint Nicolas, jusqu'au moment où, parvenant au bout de l'enfance et au seuil de l'oubli, ils participaient à la grande quête. C'est ainsi que, contrairement à ce que tous répètent, il y a bien une partie non bue de la collecte des étudiants de Liège. Celle-ci est envoyée à la prison de Lantin, pour les soins d'un certain Nicolas Merin.
Sceptique de nature, je refusai évidemment de croire qu'un homme vieux de dix-sept siècles vivait dans la région Liégeoise. Mais les témoignages que je recueillis auprès des femmes « anges des prisons » et de quelques ex-prisonniers ne me laissèrent que quelques doutes sur l'existence de ce prisonnier hors du commun. Je ne fus certain de mon fait qu'en allant moi-même rendre visite au sieur Nicolas Merin.
C'était l'homme de la légende, incontestablement.
Vous ferai-je part de mes preuves ?
Non. Pas si mes mots doivent mettre en péril la tranquillité d'un saint homme.
Combien de grands magasins ne feraient tout pour avoir, chez eux, le véritable Saint-Nicolas avec sa barbe blanche. Combien ne l'obligeraient pas à poser devant un photographe avec des bonbons pour les enfants ?
Alors, comme les Liégeois, je ne dis rien, et je donne des pièces aux étudiants pouilleux.
Je me tais et je garde pour moi ce sentiment étrange qui m'étreint quelquefois lorsque, dans la rue, les voix des enfants chantent :
« Venez venez, Saint-Nicolas ! »
Les entend-il aussi parfois ?
Famille Picard
Dans la famille des surgelés, je demande maintenant le père. Un père réduit à l’essentiel : sa capacité à procréer. Un géniteur, quoi !
Comment ? un père, ce serait tout autre chose ? amour ? présence ? éducation ? Ce n’est pas juste un sac de sperme !?
Il est mort en laissant derrière lui une femme inconsolable et quelques réserves de sa semence. Un an après, elle veut donner le jour à l’enfant qu’ils auraient pu avoir, si seulement..
On peut se poser cent questions déjà jetées comme obsolètes par les bouquins de science-fiction ou se demander, pragmatique, pourquoi la veuve éplorée n’attend pas d’avoir fait son deuil pour se trouver un autre donneur. On peut aussi dire « pourquoi pas ? ça se fait tous les jours ailleurs ! »
Je m’en fiche un peu, je crois de ce qui se décidera.
Mais l’anecdote me laisse songeuse. Pourquoi pas une mère congelée ?
Je pense que j’aimerais bien ça. Elle serait à peine plus froide que ma Vénus de Milo, à peine plus inerte et sûrement moins capricieuse.
Je la sortirais quelquefois pour la contempler en silence. Elle ne pourrait même pas dire : « Aime-moi, que vont penser les gens ? ».
Ensuite, je la rangerais gentiment dans sa bière congélo. Et puis, je m’en servirais une. Une Guinness, évidemment. 250 ans déjà !
Elucider le passé : Le Liseur de Bernhard Schlink
Mais l'épaisseur raisonnable du livre, l'envie de faire une pause entre deux récits de Yama Loka terminus dont il faudra aussi que je dise deux mots, ont achevé de me convaincre de me pencher sur Le Liseur de Bernhard Schlink.
De prime abord, le texte était léger. Le jeune Michael racontait son adolescence en commençant par sa maladie, une parenthèse dans sa scolarité et l'occasion de rencontrer Hanna.
Ce qui aurait pu être banal, se présentait déjà d'élégante façon. Les impressions, intactes, le filtre d'un regard particulier. Tout ce qui précède et accompagne la rencontre est nimbé d'une lumière spéciale, celle que l'on tente de conserver, malgré tout aux instants de bonheur perdus ultérieurement.
Puis, c'est l'histoire d'amour. Une aventure sur laquelle le narrateur s'abstient de porter un jugement. Ni celui de l'enfant qu'il était encore à l'époque. Ni même celui de l'adulte qu'il est devenu par la suite. Il livre les faits, avec ses impressions. Ce sentiment d'être un homme. Les rituels amoureux du couple et en particulier celui qui donne son titre au roman: il lui fait la lecture avant de faire l'amour. Et le personnage d'Hanna, insaisissable jusqu'au bout. Elle cache quelque chose, elle dissimule une faiblesse. C'est ce que l'on perçoit derrière sa force de caractère. On peut même deviner, touche par touche son secret, mais sans jamais que soit gâché le déroulement de la suite : le procès.
Hanna est accusée avec d'autres femmes, d'avoir joué un rôle dans les horreurs de l'Allemagne nazie. Schlink analyse, avec ce récit de procès, le rapport des jeunes allemands avec le passé de leurs parents. Les aimer et leur en vouloir d'avoir commis l'inacceptable. Les haïr et se demander, sans jamais pouvoir répondre, comment, à la place de ces gens, ils auraient réagi. Découvrir qu'ils ont aimé des gens capables du pire ou simplement capable de tolérer à leurs côtés, des monstres en puissance, des humains sans héroïsme.
Pourquoi et comment une personne ordinaire devient-elle un bourreau?
La question n'est pas nouvelle. On a souvent vu des romans tenter d'explorer l'âme humaine pour comprendre "où ça dérape". On a souhaité voir des drames indicibles dans l'histoire de ceux qu'on veut appeler "monstres". On eu a envie de les réduire à une somme de souffrances et d'en tirer une équation de la méchanceté, une recette du bourreau : une pincée de maltraitance familiale, une larme de sentiment d'injustice, une pluie de pauvreté, deux mesures d'ignorance etc., etc.
C'est un peu trop facile. C'est une pente trop naturelle : Mettre le mal à distance, feindre d'en comprendre le mécanisme et se croire à l'abri de la monstruosité.
Ça fonctionne peut-être un peu quand on se penche sur le cas des serial killers ou des pédophiles d'aujourd'hui. On peut les isoler, les parer d'inhumanité, les disséquer et les croire différents.
Ça ne peut pas marcher dans un contexte tel que la seconde guerre mondiale où tant de gens ordinaires, sans traumatismes particuliers ont contribué, chacun à son échelle, à l'horreur des camps, de la haine, de la guerre.
Ils ont choisi, comme nous choisissons tous, avec les éléments que nous avons en main. Une conviction politique qui colle avec ses émotions, l'envie de servir à quelque chose et d'embrasser une cause d'envergure ? Ils ont tué sans excuses, parfois, pour des raisons qui ne pèsent pas une cacahuète sur la balance de la justice. Un mal de crâne, l'ennui, le besoin de confort, un pourquoi pas, un brin de conformisme ?
Michaël suit le procès des femmes, jour après jour et essaie de comprendre. Comprendre ce qu'a pu faire Hanna, comprendre pourquoi elle l'a fait, comprendre aussi son amour pour elle, ce qu'elle était et ce qu'elle est encore. Il tente d'affronter ses propres lâchetés et d'aller au-delà du dégoût obligatoire.
Puisqu'on aime dans les livres les échos qu'ils nous renvoient, j'ai savouré le récit de la maladie de Michaël :
«Quelles périodes magiques que les périodes de maladie, dans l'enfance et la jeunesse! Le monde extérieur, le monde des loisirs [...] ne parvient que par des bruits assourdis jusque dans la chambre du malade. Il y foisonne au contraire un monde d'histoires et de personnages, ceux des lectures. La fièvre, qui estompe les sensations et aiguise l'imagination, fait de la chambre un espace nouveau, à la fois familier et étrange; »
Il est aussi question d'insomnies : «Ce sont des heures sans sommeil, mais non de cette insomnie qui est un manque: ce sont des heures de plénitude.[...] Ce sont des heures où tout est possible, le bon, comme le mauvais.»
Ce sont ces phrases qui m'ont donné envie de poursuivre la lecture.
La place faite aux mots dans ce roman !
Lire pour ceux qu'on aime.
Partager ses lectures.
Le don de mots est une greffe de sens.
J'ai trouvé saisissant le passage où est décrite l'anesthésie face à l'horreur : «Moi qui étais là tous les jours, j'observais leur réaction avec un certain recul. Tout comme celui qui dans un camp de concentration, a survécu mois après moi et s'est habitué, et enregistre froidement l'horreur qu'éprouvent les nouveaux arrivants. La perception qu'il en a est anesthésiée, comme celle qu'il a des morts et des meurtres quotidiens.» L'anesthésie atteint sans discernement et les victimes, et les bourreaux. Même les juges et les observateurs. L'horreur ne peut pas être disséquée, parce qu'elle n'est pas mortelle. Elle ne se range pas sur les étagères de l'histoire. Elle ne devient pas inerte sous les couches de poussière. Elle est de l'ordre de l'indicible, de l'incompréhensible.
«Nous ne devons pas nous imaginer comprendre ce qui est inconcevable.»
La difficulté d'élucider le passé est présente dans tout le récit, que ce soit pour évoquer l'histoire collective ou pour dépeindre l'aventure de Michaël et Hanna. L'auteur a le courage d'admettre qu'il ne comprend pas, qu'il ne sait pas par quel enchaînement de causalités les événements se sont produits.
C'est la moindre des honnêtetés.
L'issue du récit surprend, pouvait-on en imaginer d'autres ?
Hollywood l'aurait fait.
La vie s'en dispense. Elle ne cherche pas à séduire.

Enfin, ce livre se termine sur une réflexion sur l'écriture. Qu'écrivons-nous?
«Que l'histoire que j'ai écrite soit la bonne, c'est le fait que je l'ai écrite qui le garantit, et que je n'ai pas écrit les autres. La version écrite voulait être écrite »
Les faits ne se laisseraient écrire qu'après l'apaisement. Exorciser, oublier, fixer, classer ou transformer une histoire ne sont pas des motivations valables aux yeux de Schlink.
«Je pense qu'elle est exacte, et qu'à côté de cela, la question de savoir si elle est triste ou heureuse n'a aucune importance.»
Puis il parle du passé avec des mots qui entrent en résonnance avec mes propres impressions :
«Les strates successives de notre vie sont si étroitement superposées que dans l'ultérieur nous trouvons toujours de l'antérieur, non pas aboli et réglé, mais présent et vivant.»
Commentaires
1. k_tastrof le 24-05-2009 à 22:37:52 (site)
Il a fallu que je recherche une image d'illustration pour apprendre qu'il existait un film tiré de ce récit. Inculture, quand tu nous tiens !
2. EBL le 26-05-2009 à 18:08:26
J'aime les lectures qui nous hantent longtemps... Après Le Liseur, laissons place à A Lesson Before Dying...
3. k_tastrof le 26-05-2009 à 19:20:39
Qui hantent comme cela ?
«Il y foisonne [...]un monde d'histoires et de personnages, ceux des lectures.»
Est-ce qu'on ne devient pas dingue avec tous ces gens dans la tête? Est-ce qu'on n'en perd pas ses repères entre le réel et l'imaginaire?
4. EBL le 28-05-2009 à 22:32:02
Je me sentirai bien vide sans ces personnes... Elles me font parfois (souvent) oublier le réel...
Est-ce que la cour dort ?
Aux Antilles, les veillées, pas forcément mortuaires, sont peuplées de contes qui commencent souvent, comme partout, par un échange rituel entre le conteur et son public:
« Hé ! Cric !
– Hé ! Crac !
– Yé Misticric !
– Yé Misticrac ! »
Alors l’histoire peut commencer et le conte, après le dialogue, prend la couleur indéfinissable des métissages les plus audacieux :légendes d’Afrique et des Caraïbes, contes populaires français et récits venus de la Chine ou de l’Inde et des héros qui sont des crabes, des tigres, des araignées, des singes ou des lapins, des poissons ou bien des humains, noirs de peau avec un dieu blanc ou des dizaines de divinités.
Lorsque le conte est bien lancé et que le conteur craint d’ennuyer ou de se sentir seul, il lance de nouveau une formule pour vérifier que fonctionne l’écho:
« Cric ?
– Crac !
– Est-ce que la cour dort ?
– Non, la cour ne dort pas. »
Mais que se passe-t-il quand on n’entend plus rien ? Est-ce le conteur qui s’est endormi ? Tous ces mois sans une note, si je n’ai plus cherché vos échos, si je n’ai pas lancé de formules, c’est que la vie, celle de tous les jours, ne m’en a pas laissé le temps.
Il y a eu les fêtes et leurs lots de questions, 2009 et des cadeaux de la vie, énormes et inattendus, qu’il a fallu intégrer à l’ensemble, des refus agréables et des publications sympathiques ou parfois décevantes, l’aboutissement de vieux projets et de nouveaux textes écrits, quelques soumissions par-ci par-là avec le suspense habituel : conviendra ? conviendra pas ?
Un événement aussi, qui a fait date, à plusieurs milliers de kilomètres de mon nombril et qui pourtant, a réveillé de vieilles questions sur l’identité : « la crise antillaise ».
C’est une histoire d’identité, oui.
C'est la crise d’un adolescent qui se demande qui il est :« Je veux être un adulte ! Rendez-moi mes parents ! »
La crise d’une ancienne victime qui n’a pas dépassé ses blessures et a cohabité des années avec son bourreau. Lorsque cette victime muette se réveille enfin, elle hurle sa douleur, sans voir que son entourage n’est plus celui que la douleur a si bien figé dans son esprit. Elle crie sa haine et réclame vengeance, car elle n’a pas su se reconstruire.
Qu’est-on quand on est tant de choses à la fois ? Accepter d’être pluriel est beaucoup plus difficile que de se réfugier dans un coin du prisme pour faire pousser de la haine sur chaque cicatrice. On rêve de sentiments simples, d’identités d’un seul bloc, sans compromis, sans dilution.
La société Antillaise n’a pas su définir les contours mouvants de son identité et de ses souffrances.
Elle en appelle aux arguments de la raison avec la passion des peuples écorchés. Le discours ne peut pas porter. L’esclavage et le chômage ne sont pas sur le même plan, le pouvoir d’achat et celui de guérir ne sont pas de même nature, l’injustice sociale et l’oppression ne sont pas sur un pied d’égalité.
Elle hurle et se trompe de champ lexical. Elle pleure et s’étonne de n’être pas comprise.
La « crise antillaise » n’est pas une révolution marxiste. C’est le cri inarticulé d’un enfant maltraité qui a grandi sans oser, sans pouvoir s’exprimer. C’est un triste malentendu.
« Est-ce que la cour dort ? »
Commentaires
1. Big Luna le 17-04-2009 à 13:38:50 (site)
Non, la cour ne dort pas ! Elle attendait que le conteur se réveille.
2. lafianceedusoleil le 17-04-2009 à 16:07:27 (site)
coucou
un petit coucou pour te souhaiter un bel après-midi.
kikou

3. xmissbzh le 21-04-2009 à 10:56:41 (site)
Non, elle ne dort pas. Me concernant, j'ai été en martinique il ya bien longtemps et je sentais déjà un malaise racial. Ce peuple connaît son histoire. Maintenant, isolé sur son île, il lui est difficile de revendiquer ses droits et certains ne supportent pas les vagues touristiques. Il yavait encor com un parfum colonial. L'esprit du blanc est ressenti envahisseur. L'identité antillaise est encor à refaire...
4. k_tastrof le 21-04-2009 à 12:39:22 (site)
@ Luna : difficile d'être éveillé en plusieurs endroits à la fois. Les rêve sont peut-être un éveil, ailleurs dans une autre dimension.
@ lafianceedusoleil : merci. un long après-midi de quelques jours.
5. k_tastrof le 21-04-2009 à 12:45:59 (site)
@xmissbzh : "Ce peuple connaît son histoire."
L'histoire? elle se lit, se relit, s'interprète en fonction de ce qu'on veut lui faire dire. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas encore, officiellement d'histoire des Antilles Françaises dans les manuels. On apprenait les noms des rois de France, ceux de fleuves situés à 8000 km.
Le traitement par le silence a bel et bien existé. Le non-dit se refoule, reste inconscient et devient potentiellement destructeur. Cette haine, je l'ai vue s'exprimer ouvertement ou plus discrètement.
Si je n'avais pas été une sorte d'exilée de l'intérieur, peut-être l'aurais-je ressentie moi-même, sans me poser de questions, sans m'en rendre compte.
Mes Heures Ovales
Au bout d’une journée comme celle-là, en octobre 2006, j’avais griffonné dans un carnet les premiers mots d’un texte qui est devenu Heure Ovale. Rangé avec les autres dans un dossier de mon PC, il dormait, éteint, désormais inutile.
Cet après-midi, je me demandais quelle pouvait être la couleur réelle de mon bureau sous le tapis des feuillets morts de mes préoccupations professionnelles. « Il faudrait mieux organiser tout ça, quand j’aurai un peu de temps ! » Deux ans après, j’ai alors repensé à Murielle et à ses soucis d’heure ovale.
Murielle pensait tout haut. Depuis une semaine, elle éprouvait le besoin de mettre en mots sonnants ses tentatives d'organisation, pour ne pas les laisser s'envoler, poussées trop fort par le vent de la folie naissante.
«Je ne suis pas folle, répliqua-t-elle pour se rassurer. Juste un peu débordée.
Imaginaire culinaire, Littérature générale et fantastique
Je ne sais pas appartenir
Peau Douce ou l'aventure internationale d'un texte de 2 pages
Commentaires
1. Transhumain le 25-11-2008 à 22:01:31
Je ne savais pas que tu faisais aussi dans les schizos, Ketty !









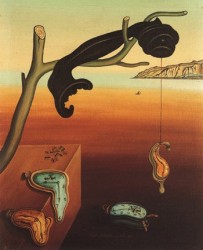
Commentaires