Des vies, des vies pas les mieux, pas les pires !
Des mois et des mois déjà depuis le dernier post !
Du temps, beaucoup. Et moi qui croyais sincèrement en manquer! Qu'avez-vous fait pendant vos soirées d'hiver, vos week-ends et vos congés ?
Moi, j'ai écrit. Relu. Envoyé. Mais, surtout, j'ai lu.
Une ultime relecture de mon gros projet autobiographique, le plus ambitieux de toute ma vie, avant de le confier à l'éditeur qui a déclaré vouloir le publier (Je vous en dirai plus d'ici la rentrée 2012/1013).
Ce simple envoi m'a plongée dans des abîmes de questionnements sur l'écriture, sur ses liens avec l'intimité, sur l'importance de se taire et l'obligation de parler, sur la légitimité de mon besoin d'écrire, sur l'unicité banale d'une vie d'humain.
La lecture seule pouvait m'aider à chercher, à creuser, peut-être même à trouver du sens au chaos ainsi invoqué.
Après Écrire, de Marguerite Duras, seules les Vies Minuscules de Pierre Michon voulaient bien se laisser lire.
C'est étrange cette façon qu'ont les livres de se présenter à vous, ouverts, prêts à être pénétrés ou alors fermés, décidés à vous refuser.
Vies Minuscules, donc, en partie à cause de Shalmaneser, le plus fervent disciple de Michon, et de sa façon d'en parler et à cause de la librairie Charybde.
Peut-on écrire sans s'écrire ?
Livre lu, voici les questions soulignées : Peut-on écrire sans s'écrire ? Peut-on écrire en évitant de salir les mots sacrés avec la crasse du commun de l'existence ?
Et voici les phrases qui, à cause d'un trait de crayon resteront bien après la dernière page.
Des réflexions sur le temps, ma plus grande angoisse à ce jour, et sur la supériorité évidente des vivants sur les morts. Ceux-ci ont bouclé la boucle et souffriront n'importe quelle lecture de leur existence alors que ceux-là, en réajustement perpétuel, s'échappent toujours des cases de nos grilles de lecture.
« ... mais les morts ont le temps de s'attarder, nul désir effréné de leur fin ne les tire plus en avant.»
« Les choses du passé sont vertigineuses comme l'espace, et leur trace dans la mémoire est déficiente comme les mots : je découvrais qu'on se souvient.»
J'y ai aussi trouvé des échos à mes questionnements sur le pouvoir supposé des mots. Des mots puissants, quelquefois insuffisants, qu'on désire malgré tout, faute de mieux, qui, tour à toutr, nourrissent l'espoir et déçoivent cruellement.
« Que les mots sont vastes, qu'ils sont douteux. »
« Si l'Écrit m'était donné, pensais-je, il me donnerait tout.» puis « “Si l'Écrit t'est donné, il ne te donnera rien.” : je m'étais mis au pied du mur, et je n'étais pas maçon.»
« Le désert que j'étais, j'eusse voulu le peupler de mots, tisser un voile d'écriture pour dérober les orbites creuses de ma face ; je n'y parvenais pas; et le vide têtu de la page contaminait le monde dont il escamotait toute chose. »
« Je ne savais pas que l'écriture était un continent plus ténébreux, plus aguicheur et décevant que l'Afrique, l'écrivain une espèce plus avide de se perdre que l'explorateur; »
J'y ai également trouvé des résonnances puissantes avec mon absence de parents (ou la présence entêtante de mes parents insuffisants, ce qui revient au même) :
« ... fils perpétuel de la toute-absence du père et la fuite des femmes..»
« Le père cependant mûrit, la graine d'absence en lui germa, quand on pouvait croire seulement qu'y dépérissait l'espoir; »
D'autres passages sont soulignés parce que beaux, poétiques, intrigants.
D'autres encore qui, faute de crayon à portée sont restés noyés dans le reste et ces pages entières où il aurait fallu tout souligner.
Une lecture torture voluptueuse dont je suis sortie changée.
Que lire ensuite ? Difficile à dire.
Qu'écrire après ça ?
L'évidence même. Un projet abandonné devant la difficulté à développer des vies que je ne connais que très mal et qui, malgré tout, ont pesé de tout leur poids sur ma vie, sur ma plume et mes séances de divan. Mes vies minuscules à moi ont retrouvé une légitimité après la lecture des 250 pages et 8 vies racontées par Pierre Michon.
Comme cochons
Un passage de Lolita de Nabokov met en scène, de la même façon, des aubergistes porcins et leur clientèle grossière, vus par le délicat et cultivé Humbert Humbert, tout impatient d’approcher les nues.
A la casserole
Voici la Pâte à tarte à la casserole
En revenant d'Utopie
Les Utopiales de Nantes, un de ces rendez-vous où certains ont choisi de se montrer en treillis ou en peluche-bas-résilles !
Une de ces étapes de l'année où se mesure et se corrige l'écart pris, sans s'en rendre compte, avec ce que l'on est.
J'y suis allée sans le masque ni l'armure auxquels nous contraint le quotidien. Je ne représentais que moi, mon livre, mes travaux, mes pensées délirantes.
Forcément, j'en reviens, le cœur et la tête débordants de souvenirs.

Des conférences, des expos, des tables rondes et puis un film, Verbo. Qui a réussi à me lacérer de l'intérieur, à me couper le souffle, à pulvériser les barrages de mes larmes. Un plaisir atroce, comme un de mes cauchemars, en mieux réalisé ! Faut-il maudire ou adorer Eduardo Chapero-Jackson?

Mais ce qui reste, qui nourrit, qui tient chaud, c'est tout le reste. De belles rencontres, certaines même, très touchantes, des retrouvailles, des fous rires, des conversations à bâton rompu, jusqu'aux heures les plus indues, des livres, trop comme toujours, et une cure de bière interrompues, juste le temps de changer de verre.
Cette année, soleil oblige, il convient de rajouter des terrasses, une balade en bateau, quelques pas dans Trentemoult, la visite du château (enfin !) et pour la touche futile, un énième collier, nouvelle pièce de la série "osons quelques gouttes de couleur".
Alors pour quelque temps, plus rien ne peut m'atteindre.
Ni les enfants surexcités du train retour, ni les révélations intimes de l'ado dans le métro, ni les sanglots téléphoniques de la quinquagénaire aigrie, ni même l'affluence sur la ligne 4.
Rien ne peut me voler cette satisfaction : cette année encore, j'y étais.
Boire ou Écrire
L'été, j'ai du temps alors j'écris. L'été, j'ai du temps, alors je lis. Je n'ai pas les moyens de séparer les deux, pas la patience de remettre l'un de ces besoins à plus tard pour mieux assouvir l'autre.
Cet été donc, plutôt que de m'attaquer à la terrible pile à lire, désormais disloquée et répartie dans plusieurs bibliothèques, j'ai empilé les derniers livres que m'ont offerts des amis assez sûrs de leurs goûts pour prendre ce risque et, en entrecoupant de textes puisés dans ma toute nouvelle liseuse, je les ai lus.

Il y a eu d'abord Crise d'asthme d'Etgar Keret , un recueil de nouvelles surprenantes : parfois surréalistes, parfois grinçantes ou encore, trait que je n'ai vu que chez quelques auteurs juifs, joyeusement désespérées. Bien que réalistes, la plupart du temps, les textes, très courts, trempent largement dans un fantastique adulte qui rappelle néanmoins les fables pour enfants. Ce livre m'a rappelé le plaisirs que je prenais à noter dans mon carnet l'absurde ou le merveilleux de situations réelles. Il faudra recommencer.
Après un interlude consacré à la lecture d'Incarnation, un roman de Xavier Bruce, j'ai repris la pile de cadeaux et glissé dans un Volodine, sans savoir si, cette fois, il m'accepterait. J'étais restée sur un échec avec seulement quelques pages des Anges mineurs.
Lisbonne dernière marge a bien voulu de moi. J'en garde un souvenir cotonneux, comme un nuage cueilli morceau par morceau et qu'il faudra laisser se condenser puis décanter longuement. L'histoire, car il y en a une, c'est celle d'Ingrid, une terroriste qui, avec son amant policier, passe au Portugal ses derniers jours sous son identité véritable. Elle doit se faire oublier dans un pays d'Asie d'où elle ne reviendra pas avant au moins quinze ans. Ingrid explique à celui qu'elle surnomme « Mon Dogue » qu'elle va passer tout ce temps à écrire. Et elle lui livre des pans entiers du livre crypté qui vit déjà en elle. Il ne croit pas que l'idée soit bonne. On n'écrit pas les mêmes choses, on ne brasse pas le même inconscient quand on est une terroriste idéaliste ou quand on est un écrivain soucieux d'art. Le livre se déploie devant lui, devant nous. Il parle de systèmes, de groupes d'écrivains, d'histoire falsifiée, de vie, de mort, de formes artistiques et surtout d'écriture. Le livre d'Ingrid et celui de Volodine continuent de résonner encore et encore.
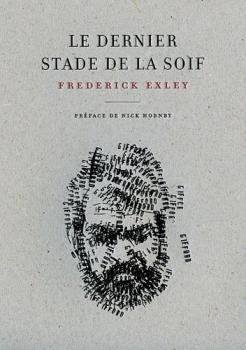
L'heure est venue, ensuite, de me pencher sur l'objet le plus intimidant de la pile. Un beau livre gris, couverture en carton pilé, avec un immense bandeau rouge, me signifiant que sa lecture serait un grand moment. Avec l'accord écrit de l'éditeur(si, si), j'ai ôté le bandeau et commencé Le Dernier Stade de la soif de Frederick Exley
Pendant que je tâchais, dans mes propres travaux, de ranimer un Frédéric fan et une star américaine ne voulant plus de ce statut, je découvrais le récit d'un américain, Frederick Exley, lui-même, très tôt persuadé d'avoir sa place parmi les plus grands. Cette certitude, loin de le porter à la réussite, fait partie des raisons de son autodestruction. Fan de football et, plus particulièrement, de Frank Gifford de l'équipe des Giants, il vit de l'intérieur la gloire de son idole (la version originale s'intitule A Fan's notes) et se crée un monde idyllique qui prend le pas sur la réalité, le menant de bar en bar, du nord au sud des États Unis d'Amérique, en passant par l'asile psychiatrique, jusqu'au dernier stade de la soif. Échec après échec, Fred Exley se voit sombrer, lucide, horriblement lucide.
Ce livre est aussi l'histoire, décousue, de sa propre rédaction, de sa naissance dans la douleur en 1968. Pas une fiction légère, pas un livre sympa, mais la vie, laide et tenace d'un timbré alcoolique. Un grand livre !
De ceux qui donnent envie d'écrire une note de Blog.
Je pense que je vais remettre le bandeau.









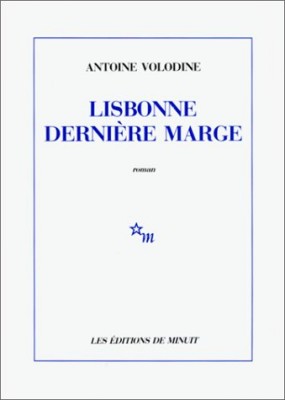
Commentaires