Une Poupée en chocolat
Lire Une Poupée en Chocolat tout en m’occupant du lancement dans le monde de mon dernier livre, L’Évangile selon Myriam, était un véritable défi.
Le livre d’Amandine Gay ne se contente pas de l’énergie résiduelle des fins de longues journées. C’est un texte exigeant, dense et impitoyable qui vous veut en pleine forme et réclame une attention entière.
Je l’ai commencé à la mi-octobre et, au rythme que m’ont permis les semaines de travail, la thèse, les week-ends de festivals en France et ailleurs, il m’a fallu un mois pour en venir à bout.
La richesse d’un mille-feuille
On commence à connaître mon goût pour les lasagnes et leur équivalent sucré, le mille-feuille.
Une Poupée en Chocolat alterne des moments de la vie de l’autrice et des passages théoriques un peu arides, que la promesse d’une nouvelle tranche de vie rend plus simples à ingurgiter.
On sait, de toute façon, que les chiffres et les analyses ainsi présentés sont indispensables à la compréhension fine de ce qui a fait Amandine Gay, de son récit de vie.
En fait, avec ses 365 pages (une par jour de l’année ?), elle invite la lectrice à refaire avec elle, brique par brique, la construction de sa cohérence, de son identité fluide et multiple d’aujourd’hui.
Des échos
Comment ne pas trouver, entre les apports sociologiques divers et les récits plus personnels, de vagues ressemblances avec ma propre histoire?
En réalité, j’ai été surprise du nombre de points communs pouvant exister entre cette femme adulte, adoptée dans une famille aimante et moi-même, abandonnée au sein même de ce qui aurait dû être ma famille.
Le film « Une Histoire à soi » m’avait rappelé le nombre de fois où, enfant, j’avais rêvé d’être adoptée, souvent par une mère blanche qui serait forcément mieux que la mienne, et avait attisé un sentiment diffus de culpabilité.
Le livre l’a dissipé. Ce que je prenais pour des murs m’a tout l’air d’être des ponts.
Si j’ai pu grandir entourée de gens qui me ressemblent, ma chance n’en était pas vraiment une. Ma mère m’a tôt fait savoir que j’aurais mieux fait de ne pas naître et, avec toutes ces personnes censées me protéger, elle m’a permis de découvrir différentes nuances de la maltraitance.
« J’ai déjà évoqué ma conviction profonde dès l’enfance d’être spéciale, ce sentiment que le début de vie hors du commun qui a été le mien ne peut s’expliquer que par le destin hors du commun qui m’attend.»
C’est par ces mots qu’Amandine Gay introduit le complexe de Moïse. Pour reprendre à mon compte cette histoire biblique (une de celles qui ne font étonnamment pas partie de l’Évangile selon Myriam), c’est comme si mon panier avait dérivé longtemps sans jamais rencontrer de princesse, au point que j’aie dû ramer un temps, sauter du panier trop petit et apprendre à nager seule pour infiltrer, à force de volonté démente, la compagnie des puissants.
N’est-ce pas ce qu’on appelle un destin exceptionnel ? Quelle obligation m’a poussée ? Quelle revanche restait à prendre ? N’était-ce pas une façon de justifier qu’on m’ait laissée vivre malgré tout ?
Je comprends mieux, après cette lecture, pourquoi le motif de l’adoption revient sans cesse et s’impose dans plusieurs de mes écrits aux côtés de celui de l’enfant de trop. Dans Eugénie grandit, bien sûr, mais aussi dans Six faces d’un même cube qui l’explore différemment et d’autres textes à paraître.
J’ai trouvé dans ce livre, dans cette vie qui n’est pas la mienne, comme un écho.
L’écho, c’est quand ça touche quelque chose.
L’écho, c’est une répétition, mais un peu différente.
Ont résonné de même, le dedans-dehors, le Gospel, Dieu, la vie, la gynécologie, les familles où on se réfugie, l’accusation d’être une Bounty, pas assez vraie, pas assez authentique, jamais au bon endroit….
Des racines impossibles.
J’ai retrouvé dans le livre d’Amandine Gay qui, au fur et à mesure des pages, devenait un peu le mien, cette quête existentielle qui m’a occupée une bonne partie de ma vie.
Quelle inscription dans l’histoire de l’humanité quand ceux qui vous ont donné vie vous expliquent qu’ils auraient vraiment préféré ne pas ?
Que chercher dans ce non-désir de soi ?
Quelle histoire bâtir avec un non-commencement ?
Comment ne pas préférer la fuite en avant ?
Aujourd’hui, je me reconnais dans ces mots :
« Et je me connais désormais assez pour comprendre ce qui fait naître en moi le désir de création : je suis devenue une artiste, car c’est l’identité qui comprend toutes les autres et me permet d’être la fille de mes œuvres. »
« Je ne sais pas appartenir », écrivais-je au début des années 2000, quand, exilée en Belgique avec mon compagnon d’alors, je cherchais à rassembler les pièces de ce qu’il me semblait être et songeais à rédiger ce qui est devenu, dix ans plus tard, Noir sur Blanc.
Ma non-appartenance est encore là. Ce n’est pas un simple refus des étiquettes. C’est la traduction d’une incapacité à m’inscrire dans un groupe quel qu’il soit.
Mes tentatives pour recréer quelque chose qui ressemble à une famille n’ont connu qu’un succès limité. J’y ai renoncé pour une sorte de communauté flexible aux liens lâches et aussi peu contraignants que possible.
Pas de liens, pas de parachute.
Je n’ai que mes œuvres et ceux qu’elle me permet de rencontrer. Certains restent. Longtemps. C’est terrifiant.
La Guérisseuse blessée
Je n’ai pas manqué de relever, tout au long de ma lecture, les évocations de ces gens qui exercent la profession que j’ai récemment embrassée. Psychologue.
Ceux qui font du mal, ceux qui font du bien.
Ceux qui croient savoir déjà, ceux qui écoutent pour de vrai.
Plus d’une fois, j’ai eu peur d’être une mauvaise psychologue à cause de mes nombreuses fêlures. Qui a lancé cette légende qu’il faudrait être sans faille pour pouvoir aider les autres ?
La « culpabilité des soignantes de n’être jamais pleinement guéries elles-mêmes » dit l’autrice.
Mon propre psychothérapeute, il y a ... longtemps, me disait pourtant : ne pensez-vous pas que nous sommes des gens comme vous qui avons peut-être trouvé quelque chose ?
Faire un travail sur soi avant d’aider me semble indispensable, mais c’est justement ce qui permet de savoir ce qui est ma blessure, ce qui est celle de l’autre et ce qui, dans la mienne, me permet d’être à l’écoute autrement qu’avec les mots.
Alors, je ne suis pas à l’abri d’être une mauvaise praticienne, mais ce ne sera pas pour cette raison-là.
Comme Amandine Gay, je me reconnais dans la figure de la guérisseuse blessée. Pas pour pleurer, pas pour me lamenter, mais pour attester que « Même pas morte », il est possible d’apporter ce dont on a pu manquer.
Can I have a testimony?
L'Evangile selon Myriam
Noir sur Blanc
Six Faces d'un même cube
Une Histoire à soi
Une poupée en Chocolat
L’Évangile selon Myriam, 2 ans déjà
Début octobre 2019, diplôme de psychologie en poche, épuisée par les efforts fournis pour la session d’examens de septembre, le mémoire, sa soutenance, par l’absence de vacances et la rentrée des classes, je faisais le point sur l’avancement de mon projet littéraire en cours.
Un concept un peu fou, 43 chapitres prévus, 6 à revoir, 14 à écrire de A à Z, soit près de la moitié du manuscrit à transférer du monde de «Je vois à peu près ce que je veux en faire» à l’état «Voilà, c’est écrit.»
Le 5 janvier 2020, c’était chose faite.
Le projet de l’ombre, construit sans modèle, pouvait quitter le disque dur de mon ordinateur pour aller conquérir le vaste monde.
Une épidémie, une reconversion, un projet de thèse et deux reports plus tard, l’Évangile selon Myriam est enfin un vrai livre, publié aux éditions Mnémos.
– chez votre libraire dès le 8 octobre
– aux Imaginales d’Épinal du 14 au 17 octobre
– en vedette à la librairie Charybde le 21 octobre à partir de 19 h 30.
D’autres rendez-vous viendront et seront annoncés ici.
On ne traverse pas la mangrove.
Le titre du roman de Maryse Condé que j’ai lu, il y a quelque temps, m'a fait sourire. C’est toujours une mauvaise idée de traverser la mangrove. On peut la contourner, on peut, comme l’ont fait les promoteurs aux Antilles, la combler, mais aucune de ces opérations ne suffira pour échapper à la lourdeur humide et fétide de la mangrove.
J’ai décidé d’intégrer l’autrice guadeloupéenne à mon programme de lecture de fictions en constatant la violence du sentiment de perte provoqué chez moi par l’annonce mensongère de son décès sur les réseaux.
Il m’apparaît qu'avoir grandi en Martinique, même sur des modalités particulières, même en suivant des chemins bricolés, a contribué bien plus que je ne le pensais à faire de moi celle que je suis. Pour vouloir fuir un endroit, il faut déjà y être, n’est-ce pas ?
« Tu vois, j’écris. Ne me demande pas à quoi ça sert. D’ailleurs, je ne finirai jamais ce livre, puisque, avant d’en avoir tracé la première ligne et de savoir ce que je vais y mettre de sang, de rires, de larmes, de peur, d’espoir, enfin de tout ce qui fait qu’un livre est un livre et non une dissertation de raseur, la tête à demi fêlée, j’en ai trouvé le titre : “Traversée de la Mangrove”.J’ai haussé les épaules.
– On ne traverse pas la mangrove. On s’empale sur les racines des palétuviers. On s’enterre et on étouffe dans la boue saumâtre.
– C’est ça, c’est justement ça. »
J’y suis retournée avec les Confessions d’une séancière, pour constater, avec le recul du temps et de la distance, ce qu’il me restait des récits surnaturels des Antilles et leur lien avec les questions de société qui m’importaient alors. Quelle lumière de vérité cette fiction-là pouvait-elle jeter sur notre monde d’humains ?
L’Évangile selon Myriam va faire le tour, quant à lui, de la mangrove de la vérité, directement. Quel angle, quel récit pour la donner à voir ?
J’ai des idées de mangroves à visiter encore, les approcher seulement, tenter de les cerner, mais jamais les traverser, car je sais qu’on n’en revient pas.
L'évangile selon Myriam chez Mnémos
Noir sur Blanc chez Babelio
Traversée de la mangrove chez Mercure de France
Le vieil homme, la mer, la guitare et moi
Retour de la plage, je me suis baignée, je marche un peu flottante.
J’entends une guitare. J’aime décidément cet instrument !
J’avance.
Un vieux avec une guitare. Il est rose avec des cheveux blancs.
J’écoute. Il joue Manhattan Kaboul. Il chante, mais c’est une version bizarre. Deuxième voix ?
Merde, je me suis arrêtée trop longtemps. Il m’a repérée. Il me parle.
– Vous la connaissez ?
– Un peu.
Il joue… J’essaie d’être polie, de chantonner le refrain. Impossible.
En fait, il chante faux, se trompe sur ses accords et n’a aucun sens du rythme.
Je grimace derrière mon masque. Fuir…
Trop tard. Bien trop tard. Je n’ai pas l’énergie de courir.
Il se met à commenter.
« C’est une très belle chanson sur nos différences. On ne sera jamais capables de se comprendre, c’est ce que ça raconte.
– Pourtant les points de vue sont tous réunis dans une même chanson. N’est-ce pas la preuve que, malgré tout, le dialogue est possible ? »
Mon Dieu, mais qu’est-ce que je raconte ? C’est une foutue chanson de Renaud. Le mec qui a chanté « Connard de virus » ! Ressaisis-toi.
Le type sourit et fouille dans son sac.
Il en sort une partition avec les accords notés au crayon.
« Ah ! Celle-là, je suis sûr que ça va vous plaire !
– Euh ? Je ne sais pas… »
Je me méfie. Je connais cette assurance qui s'appuie sur pas grand-chose.
J’ai eu raison.
« Elle arrivait de Somalie, Lili… »
Merci, Ducon, je sais que je suis noire.
Il a l’air content de lui.
Je dis « Ouais, bof ! »
Il déclare : « C’est une belle chanson, ça parle de… »
Je le coupe.
« Je connais, merci. Je pense qu’on a tort, décidément, d’être obsédé par les différences. Franchement, ça ferait du bien si…
– Oui, c’est vrai. On est pareils, on est de la même espèce. Ce sont nos ancêtres, ils ont eu tort de se croire supérieurs. Mais il faut nous pardonner à nous aujourd’hui. C’était avant. C’est fini, ça.
– Bah, écoutez, je n’en suis pas certaine. Il arrive que l’on continue, comme avant. Sans y penser, quand on oublie de se poser des questions. »
Il essaie de jouer le Poème à Lou, de Ferrat. C’est presque beau, mais toujours pas de rythme.
C’est super important, le rythme !
Puis il fait La Montagne, parce que « tout le monde connaît ça. »
Alors je chante le refrain, doucement, pour dire « merci ».
Et un peu « Au secours. »
C’est laborieux avec ses temps changeants.
Il me dit « Bravo » avec un brin de condescendance.
Il s’excuse de son jeu imparfait.
Il dit « Je suis retraité, je peux m’améliorer. »
Je le crois modeste. Je lui dis : « Il y a juste un problème de rythme, mais… »
Il répond sèchement : « Pas du tout, j’essayais de vous suivre, c’est pour ça ! »
Il est temps de prendre congé.
Je remercie et je m’en vais.
J’ai passé le reste de mon séjour à craindre de le croiser de nouveau.
Je portais des habits différents et je tendais l'oreille.
C'est bête, il aurait été infoutu de me reconnaître, de toute façon.
Writever ce qui change en avril
L’utilisation du mot clé #writever est nécessaire et suffisante pour que la participation soit prise en compte. Nous sommes passés de 15 participants en novembre à plus de 30 en février, puis à près de 100 en mars.
Aussi, relever seule, à la main, chaque micronouvelle pour la repartager est devenu chronophage et énergivore. Mon compte personnel d’écrivaine @k_tastrof, et son activité propre disparaissaient noyés sous la masse littéraire enthousiaste.
Les récits et les imaginaires étant ce dont nous nous occupons, l'équipe a accepté de d’animer de ce défi avec moi. Bob a été recruté pour relayer vos contributions sur le compte @writeverB et me permettre de retrouver le mien et faciliter le suivi.
Je reste, bien sûr. Pour écrire et lire des micronouvelles, pour en partager certaines et pour animer cette chose que nous avons créée ensemble. Vous pouvez désormais en parler autour de vous sans craindre de me submerger, nous sommes (presque) prêts.
#writever continue, donc avec quelques évolutions qui ne visent qu’à le pérenniser dans le même esprit de partage, de respect et de créativité et poursuivre l’objectif qui a été le sien dès le départ : faire de la place sur Twitter à des bulles d’espoir, d’art et d’imaginaire.



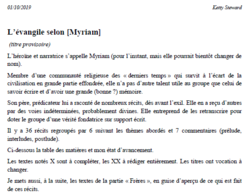



Commentaires
1. crissiette le 16-11-2021 à 10:05:01 (site)
Bonjour,
bravo pour la photo du jour!
Bonne journée!